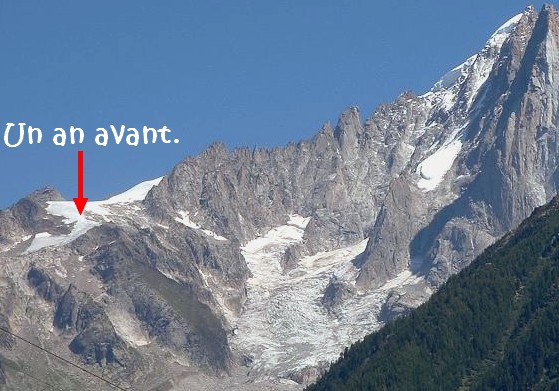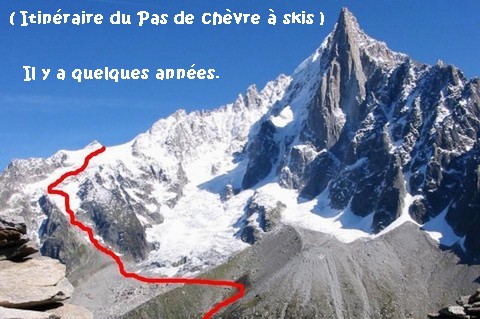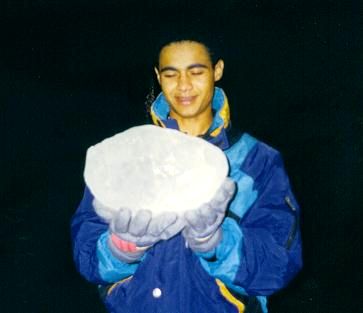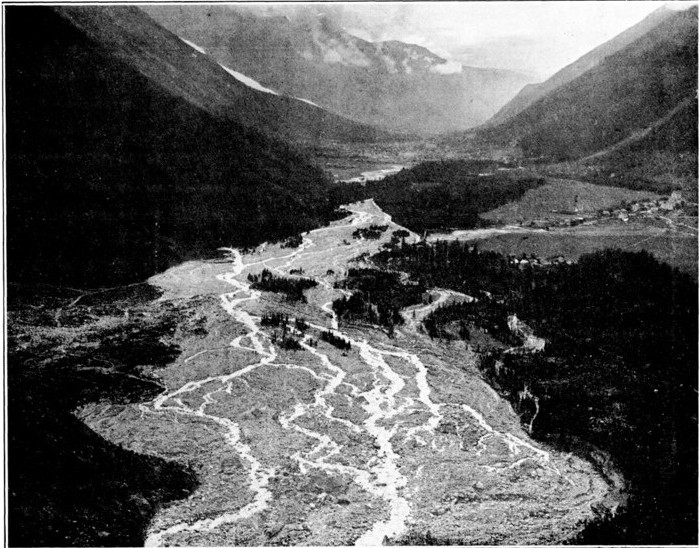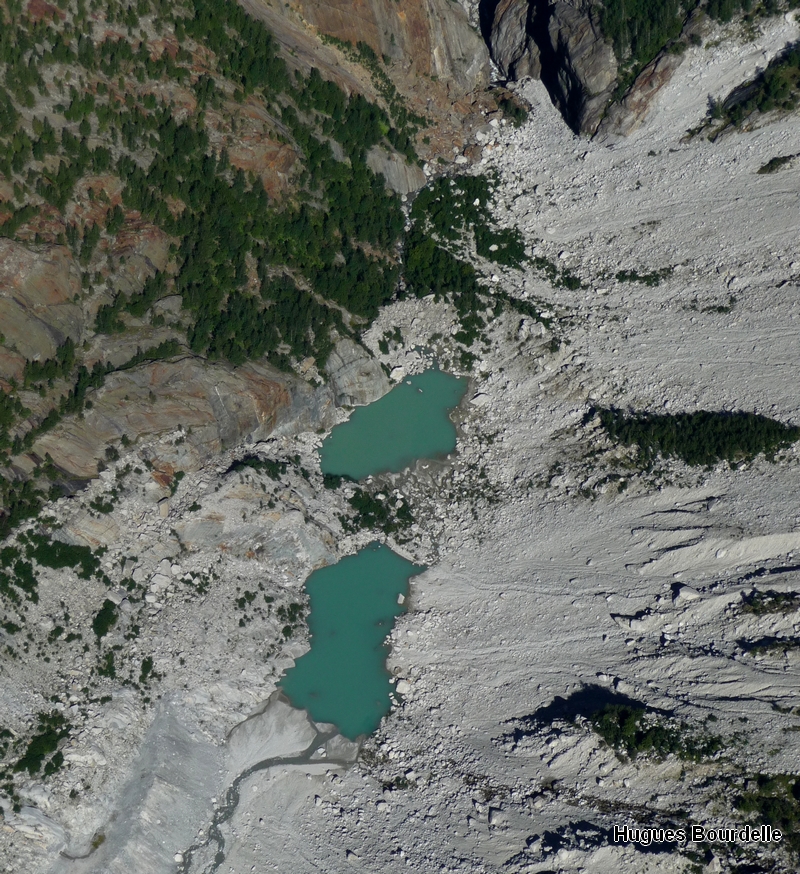Histoire...
La débâcle glaciaire de la Mer
de glace.
Le
vendredi 25 septembre 1920 a eu lieu une
crue brusque et violente de l'Arveyron,
torrent glaciaire,.émissaire de la Mer de
Glace.
L'événement est survenu
dans les circonstances suivantes :
Depuis le 17 septembre,
des pluies journalières s'étaient produites
dans la vallée de Chamonix et jusqu'à 3000
mètres d'altitude. Dans la nuit du 23 au 24
notamment, un orage assez violent avait
donné en quelques heures une lame d'eau de
56 millimètres. Une crue moyenne de
l'Arveyron en était résultée, mais qui ne
présentait aucun caractère alarmant.
Le vendredi 24
septembre, à 13 h. 30, les habitants du
village des Bois eurent la surprise de voir
soudain un jet d'eau considérable jaillir au
point de jonction de la Mer de Glace avec la
roche des Mottets. En même temps on observa
que le débit de la source de l'Arveyron, qui
émerge du pied même de la langue terminale
de la Mer de Glace, diminuait des trois
quarts.
A 15 h. 1/2, le jet
d'eau des Mottets s'arrête, la source de
l'Arveyron reprend son débit normal.
A 20 h. 1/2, la source
de l'Arveyron se met à évacuer des glaçons
assez nombreux et son débit entre en crue
légère et progressive.
A 23 h. 1/4, arrêt à peu
près complet de la source. Enfin, le samedi
25 septembre, à 0 h. 10, une débâcle énorme
se produit; une lave formée d'eau, de
glaçons, de blocs de rochers et de menus
matériaux s'échappe en torrent de l'orifice
d'où sourd l'Arveyron, puis se répand sur la
plage des Bois, divague ensuite à droite
vers les hameaux de Gaudeney et des Praz et
à gauche vers la plaine de la Frasse. La
partie la plus importante du flot suit le
canal endigué qu'elle a bien vite fait de
combler dans sa partie aval, ce qui provoque
un débordement, surtout accentué dans le
canton forestier du Bouchet.
Ce morcellement du flot
en atténue la puissance, et il n'arrive dans
la ville de Chamonix qu'une lave sans
vigueur, qui se borne à bouleverser la
scierie Taberlet et à ensabler les sous-
sols du Carlton -Hôtel, du Chamonix-Palace,
de la photographie Tairraz et de quelques
autres maisons. Aucun immeuble n'est détruit
ou même ébranlé et aucun accident de
personne n'est enregistré.
L'examen de la plage des
Bois, où se sont déposés les gros matériaux
expulsés par le glacier, montre que ceux-ci
ont recouvert une surface de trois hectares
qu'ils ont remblayée sur une épaisseur
moyenne de 5 mètres. Leur volume peut donc
s'évaluer à 150.000 mètres cubes. Il n'est
pas exagéré d'attribuer un volume au moins
égal aux petits matériaux ainsi qu'à la
glace (On a remarqué parmi les matériaux de
charriage une grande Quantité de blocs de
glace noire.) et à l'eau, et l'on peut
concevoir, dès lors, l'importance de la lave
qui en est résultée et qui a dû atteindre et
sans doute dépasser 600.000 mètres cubes.
En présence de la
grandeur de cette masse, on ne peut que
trouver relativement faible l'importance des
dégâts qui, d'après une évaluation sommaire,
a été chiffrée, tant en curage du lit de
l'Arveyron, réfection de chemins et de
conduites d'eau, dommages à la scierie
Taberlet, etc., à 990.000 francs.
L'examen du glacier
lui-même a donné lieu aux remarques ci-après
: .
Tout d'abord, la langue
terminale n'a guère changé d'aspect; deux
photographies prises par M. Tairraz quinze
jours avant la débâcle, puis immédiatement
après, permettent d'affirmer que les
quelques arrachements constatés
correspondent à un volume de glace peu
considérable.
Au-dessus de la langue
terminale, en abordant le replat de la Mer
de Glace proprement dite, on est de suite
frappé par l'impression d'affaissement que
donne la Veine Noire entre le Mauvais-Pas et
le Nant-Blanc, et par les très nombreuses
fentes fraîches qu'on y remarque, toutes
ouvertes parallèlement à la moraine et
perpendiculairement aux crevasses anciennes.
Entre le Pil-d'Argent et
le Nant-Blanc, la Veine Noire présente une
zone d'effondrement chaotique en forme
d'ellipse, dont le grand axe, parallèle à la
veine, peut mesurer 150 mètres de longueur,
et le petit axe 80 mètres. Ce sont partout
des gros blocs tout fraîchement éraillés ou
cassés et des dépressions nouvelles
inconnues du guide Ravanel (Gilbert) et du
brigadier forestier Galmiche qui nous
accompagnent.
Vis-à-vis du Nant-Blanc
on aperçoit, de plus, des crevasses toutes
récentes qui découpent la Veine Blanche. En
amont du Nant-Blanc, l'aspect du glacier ne
paraît pas modifié.
Reprenant alors les
crevasses de la Veine Blanche, nous en avons
suivi le trajet. Nous en avons observé cinq.
Curvilignes, concentriques, elles partent en
face du Nant-Blanc, perpendiculairement à
l'axe, se dévient ensuite et aboutissent,
parallèlement à la moraine, vers le Rocher
des Mottets. Ces crevasses ont une largeur
croissante de l'extérieur vers l'intérieur ;
la plus externe mesure environ 0 m. 30
d'ouverture, et la plus interne atteint 0 m.
60 *. Il est à remarquer en outre que ces
crevasses ont une allure de faille et que le
bord interne présente, par rapport au bord
externe, une dénivellation qui varie de 0 m.
05 à 0 m. 30.
La partie de la Veine
Blanche circonscrite par ces crevasses ne
paraît pas avoir subi une dislocation
analogue à celle de la Veine Noire. Elle
semble avoir simplement fléchi en masse
autour des crevasses faisant fonction de
charnières. Signalons encore que nous avons
été frappé par la sécheresse superficielle
de cette zone et par l'absence d'eau dans
toutes les ouvertures anciennes.
Deux jours plus tard, le
rédacteur de la présente note, visitant a
nouveau le glacier, constatait un
élargissement des crevasses; l'une d'elles
atteignait 0 m. 80 d'ouverture.
Nous ne saurions
assurément prétendre donner une explication
certaine du phénomène qui s'est produit les
24 et 25 septembre. Ce n'est donc qu'une
simple hypothèse que nous émettrons à ce
sujet.
Tout d'abord, nous
rejetterons l'idée que l'effondrement
partiel de la langue terminale, obturant la
gorge étroite d'où sort l'Arveyron, ait pu
être l'origine du cataclysme; car, dans ce
cas, l'eau sous pression aurait rompu la
croûte glaciaire du front bien avant de
provoquer une rupture sur la Roche des
Mottets, à 500 mètres plus haut. Voici, à
notre avis, quelles ont pu être les diverses
causes et phases de la débâcle du 25
septembre.
L'état de crue dans
lequel se trouve la Mer de Glace depuis une
dizaine d'années mettait cet appareil
glaciaire en état d'équilibre instable et le
prédisposait vraisemblablement à des
dislocations locales.
Ensuite, les pluies
abondantes de la troisième semaine de
septembre ont pu, de leur côté, occasionner
une saturation des crevasses extérieures et
intérieures de la partie aval du glacier et
surtout activer l'érosion sous-glaciaire. Le
24 septembre, à 13 h. 1/2, sous l'influence
du poids d'eau et de la disparition de
certains points d'appui, une rupture de la
voûte intra-glaciaire se produit,
probablement dans la Veine Noire, et obture
en partie le torrent sous-glaciaire au
niveau du Rocher des Mottets. L'eau sous
pression, privée d'une issue suffisante,
crève la croûte et donne naissance au jet
d'eau des Mottets; le débit de l'Arveyron
diminue d'autant.
A 15 h. 1/2, le torrent
sous-glaciaire a réussi à se créer un
nouveau cours et à retrouver son issue
normale; l'Arveyron reprend son débit
ordinaire; le jet d'eau des Mottets
s'arrête,
A 20 h. 1/2, une
nouvelle dislocation a lieu. C'est peut-être
alors la portion de la Veine Blanche limitée
par les crevasses nouvelles qui fléchit à
son tour; les crevasses anciennes se vident
et occasionnent la crue progressive de
l'Arveyron en même temps qu'un entraînement
des glaçons provenant des dislocations de la
masse glaciaire.
Puis, à 23 h. 1/4, ces
glaçons remaniés forment barrage et
retiennent les eaux du torrent glaciaire
pendant 55 minutes. La pression de l'eau
ainsi retenue devenant formidable, le
barrage, sous sa poussée, saute, et c'est la
débâcle de minuit 10 qui donne la puissante
lave de rochers, de glaçons, d'eau et de
boue.
Aucune affirmation ne
peut être émise au sujet de la possibilité
du renouvellement, à date plus ou moins
proche ou plus ou moins éloignée, de ce
cataclysme glaciaire. En tous cas, aucun
caractère inquiétant ne se manifeste dans le
glacier; aussi toutes les probabilités
sont-elles pour qu'un phénomène de ce genre,
auquel on ne connaît pas de précédent, si ce
n'est peut-être en 1700, ne se renouvelle
pas avant un temps fort long.
Il importe donc que les
populations inquiètes se rassurent et soient
convaincues qu'aucun danger proche ne les
menace. Au surplus, le fait qu'aucun
accident de personne n'a eu lieu, qu'aucune
destruction de bâtiment n'est survenue, est
une démonstration rassurante que l'heureuse
disposition des lieux, la largeur de la
vallée et sa faible pente ont permis à la
ville et aux hameaux de Chamonix d'échapper
à ce qui, dans tout autre site moins
heureusement disposé, eût constitué une
catastrophe et un désastre.
Il n'en est pas moins
certain qu'il y a lieu de prendre toutes les
précautions possibles pour limiter, en
pareille occurrence, les dégâts au minimum.
Nous mentionnerons notamment l'utilité
extrême que peut présenter, pour la
protection du village des Bois, le canton
forestier de même nom qui, malheureusement,
sous l'influence d'un pâturage immodéré,
tombe en ruine et est à la veille de
disparaître. Au point de vue hydraulique
proprement dit, l'établissement d'un lit
mineur dans la plaine de la Frasse, la
restauration de la digue du Chapitre et la
surélévation des ponts de l'Arveyron et de
l'Arve, à débouchés trop faibles, mériteront
sans doute d'être envisagés.
Chambéry, 1er octobre
1920. M.
Jourdan-Laforte. Revue de géographie alpine.
Année 1920.
Des blocs de glace de près
d'un mètre cube ont été retrouvés jusqu'à
Annemasse, à 70 kilomètres de là.
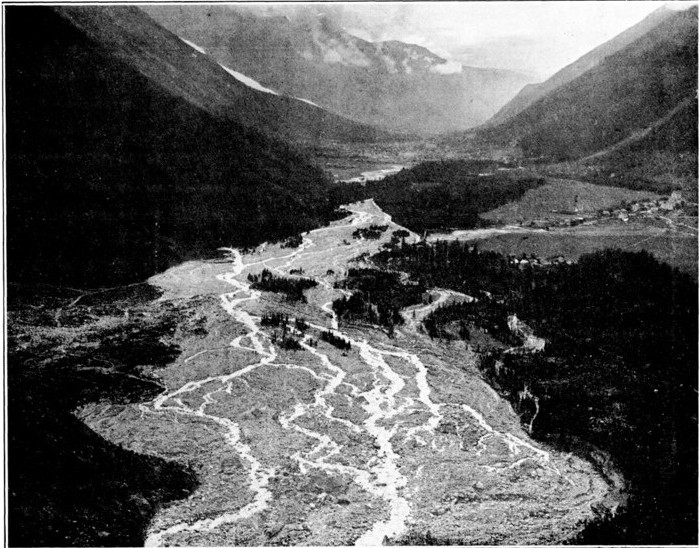

De Robert
Vivian :Photo
du 26 septembre
1920
.
|